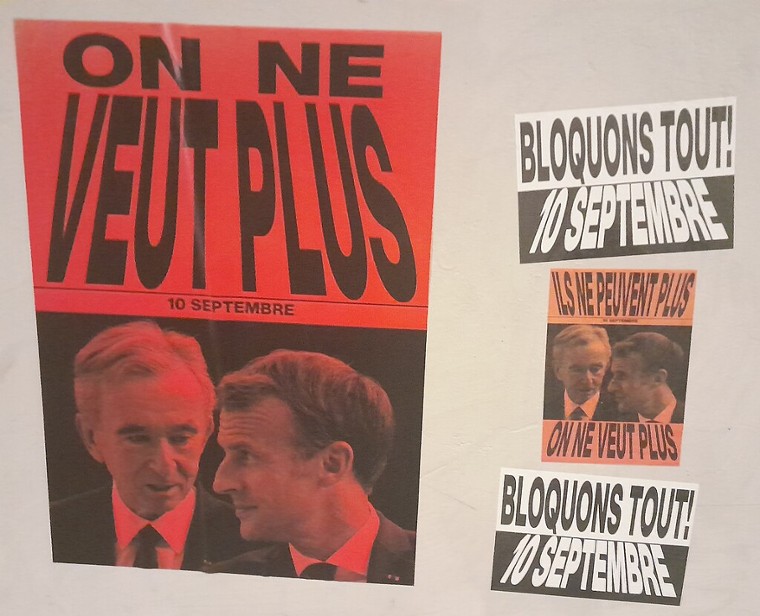Les "cités éducatives" veulent créer de "grandes alliances éducatives" au niveau des territoires pour lutter contre les inégalités. Mais sa logique change-t-elle à mesure que le dispositif se déploie ? Un article de Laurie Genet pour The Conversation.
Laurie Genet, docteure en Sciences de l'éducation et de la formation à CY Cergy Paris Université
Le principe des "cités éducatives", lancé en 2019, est de créer une "grande alliance éducative" au niveau des territoires pour mieux lutter contre les inégalités. Mais à mesure que le label se déploie, l’uniformisation des pratiques ne prend-elle pas le pas sur les enjeux d’adaptation à la réalité du terrain ?
Les "cités éducatives" sont présentées comme une réponse innovante aux inégalités éducatives. Leur ambition ? Créer des "territoires à haute valeur éducative" en mobilisant tous les acteurs locaux – écoles, associations, collectivités, institutions – autour de la réussite des jeunes de 0 à 25 ans, à l’école, mais également avant, après et autour de celle-ci.
Lancé en 2019, le label est déployé à l’échelle de 248 territoires et cible les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), majoritairement en éducation prioritaire (renforcée) (REP et REP+), particulièrement marqués par de fortes inégalités sociales, scolaires, économiques et des enjeux sécuritaires.
Une généralisation progressive du label est prévue d’ici 2027 pour les quartiers qui se porteraient volontaires. Mais derrière l’ambition d’une territorialisation, cette logique de déploiement peut-elle répondre à la diversité des réalités de terrain ?
Créer une "grande alliance éducative"
Le principe des cités éducatives est de créer une "grande alliance éducative" locale, pour transformer les territoires et réduire les inégalités. Le label a pour vocation de renforcer les coopérations entre acteurs éducatifs, culturels, sociaux, sportifs, autour de projets communs. Trois axes structurent l’action à l’échelle nationale :
- renforcer le rôle de l’école ;
- promouvoir la continuité éducative ;
- ouvrir le champ des possibles pour les jeunes.
Le cadrage national du label est volontairement large, avec l’ambition de laisser aux professionnels socio-éducatifs locaux la possibilité d’innover en réponse aux problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.
Plus spécifiquement, ce label repose sur une gouvernance tripartite – appelée "troïka" – réunissant l’État (via la préfecture), la municipalité et l’éducation nationale. À cela s’ajoute un chef de projet opérationnel (CPO), garant du déploiement local et de l’intermédiation.
Chaque année, les cités éducatives lancent des appels à projets auxquels répondent des professionnels socio-éducatifs aux statuts divers (associations, institutions, entreprises…). Les projets peuvent être diversifiés : soutien scolaire, projets sportifs ou culturels, accompagnement à la parentalité, mentorat, prévention du décrochage…
Lire la suite sur The Conversation
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.
En savoir plus